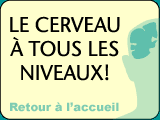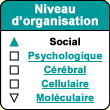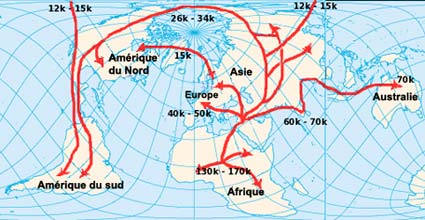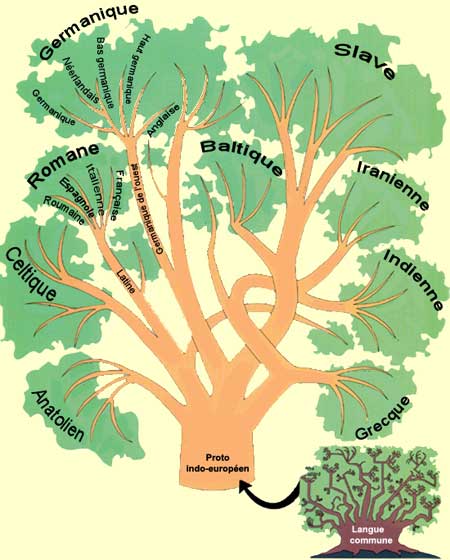|
|
|
|
 |
Communiquer
avec des mots |
 |
|
|
|
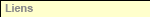
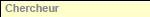
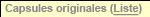
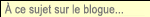
Mieux
penser le vivant en utilisant ses mots
La
spécificité du langage humain
Il existe deux grands
principes pour classer les langues. Les classements typologiques s’appuient
sur les ressemblances des objets à
classer sans s’interroger sur l’origine de celles-ci.
On distingue ainsi trois types de langues : celles où
les mots changent de forme selon leur rapport grammatical aux
autres mots de l’énoncé comme en français
(langues flexionelles); celles où les mots sont formés
en ajoutant au radical des affixes comme en japonais (langues
agglutinantes); et celles où les mots ont tendance
à être invariables, comme en chinois (langues
isolantes).
Contrairement aux classements typologiques qui ne disent rien
sur les liens de parenté entre les langues, les classements génétiques (au
sens de généalogique) cherchent à regrouper
des familles de langues dérivant d’un ancêtre
commun. Cette linguistique historique
étudie l’évolution des langues par la méthode
de la grammaire comparée. Les similarités au
niveau des sons (phonétique), du sens (sémantique),
des formes des mots et de la grammaire (morphologie) ou encore
du vocabulaire (lexicologie) sont comparées et servent
de critères pour regrouper les langues en familles ayant
la même origine. C’est la démarche des tenants
du monogénisme. |
On compte environ 6000
langues parlées actuellement dans le monde, dont 1
000 utilisées par une population très faible
en nombre. On estime que près de la moitié de
ces 6000 langues sont menacées parce qu'elles sont
parlées uniquement par des adultes qui ne les apprennent
plus à leurs enfants.
La mort des langues n’est pas un phénomène
nouveau. Depuis au moins 5000 ans, les linguistes estiment
qu’au moins 30 000 langues sont nées et disparues,
généralement sans laisser de trace. Mais le nombre
de langues actuellement parlées dans le monde diminue à un
rythme inégalé, de telle sorte que 90 % des langues
existantes disparaîtront vraisemblablement au cours du
prochain siècle. Il n’y aurait donc qu’environ
600 langues qui seraient relativement durables dont l'anglais,
qui se répand de plus en plus, et qui est en voie de
devenir la « lingua franca » mondiale.
|
|
|
Il y a tant
de théories concernant le mécanisme par lequel le langage
a pu émerger chez l’être humain que l’on
serait tenté de dire que chaque chercheur qui s’y intéresse
a la sienne ! Peu importe comment cela s’est passé,
une autre question jaillit immédiatement : cela s’est-il
passé
une ou plusieurs fois ? Autrement dit, les langues ont-elles
une origine commune, une protolangue de laquelle seraient
nées toutes les langues, ou bien y’a-t-il eu
émergence de plusieurs dialectes à différents
endroits ? Voilà qui ouvre un autre grand débat
à propos de l’origine du langage et des différentes
langues.
Ceux qui plaident pour des origines multiples du langage, ou polygénisme,
affirment que les premiers hommes modernes ne partageaient que
le potentiel de la faculté de parler. Les langues concrètes ne se seraient développées
qu’après leur dispersion, de manière indépendante
chez différents groupes d’Homo sapiens.
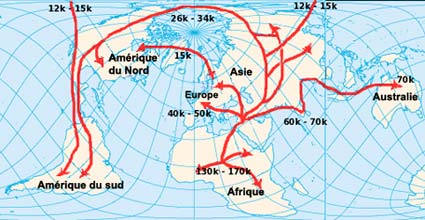
Carte des migrations humaines
élaborée à partir de la génétique
mitochondriale des populations.
Les chiffres représentent le nombre de millénaires avant aujourd’hui.
Les partisans du polygénisme s’appuient sur des événements
ou des comportements qui ont eu peu de chance de se produire sans
la parole, comme les grandes traversées qui nécessite
de s’organiser, de s’entendre, etc. Ils en déduisent
par exemple que les populations parties d’Afrique et arrivées
en Australie il y a environ 60 000 ans ont dû parler une
langue complexe avant les populations qui ont migré
vers le Moyen-Orient.
À cette thèse dite du polygénisme, certains opposent celle
du monogénisme
qui postule l’existence d’une protolangue à
partir de laquelle toutes les langues humaines actuelles
auraient dérivé. C’est le cas de chercheurs
comme Meritt Ruhlen qui tentent de remonter les racines étymologiques
des langues pour en trouver une commune.
| Cette méthode permet de remonter
avec assez de certitude à quelques milliers d'années
grâce aux traces écrites des langues. On construit
ainsi un véritable arbre généalogique
où l’on peut mettre en relation les langues entre
elles : le latin est la langue mère du français,
le polonais une langue fille du slave occidental, l’écossais
et l’irlandais des langues sœur de mère gauloise,
les langues indiennes des langues cousines des langues iraniennes,
etc. |
|
C’est ainsi qu’il existe actuellement un consensus qui
reconnaît l’existence d’environ 300 familles qui
remonteraient au début de notre ère. Les avis sont
plus partagés quant à l’existence d’une
cinquantaine de « macrofamilles »
remontant à il y a 5 000 ans environ.
Mais pour remonter au-delà de l’écriture,
qui ne constitue que les derniers moments de l’évolution des langues,
on doit essayer de reconstituer des protolangues
à partir des langues actuelles, ce qui est beaucoup
plus difficile. C’est pourquoi l’hypothèse
de 10 ou 20 « super-familles » qui auraient commencé
à diverger il y a environ 10 000 ans suscite de nombreuses
controverses.
C’est dire la polémique qui entoura la publication
en 1994 de L’Origine
des langues, un ouvrage de Merritt Ruhlen qui postule
l’existence
d’une protolangue unique il y a plus de 50 000 ans ! Ses travaux s’appuyaient
entre autres sur des études en génétique des populations
montrant une grande corrélation entre la diversification génétique
des populations humaines et celle des langues qu'elles parlent.
D’autres études montrent que les correspondances entre les classifications
génétiques des populations et les classifications généalogiques
des langues sont plus incertaines qu’on le croyait. Reste que même
si les travaux de Ruhlen sont contestés sur le plan linguistique, plusieurs
se rallient encore à l’idée maîtresse du livre, à savoir
que toutes les langues auraient une origine commune. Parmi ces partisans du monogénisme, on
distingue deux grands courants.
Les modifications neuronales
de l’hémisphère gauche accompagnant le
développement des facultés langagières
durant l’hominisation pourraient avoir débuté
il y a environ 100 000 ans ou même avant. Mais ce serait
avec l’évolution du gyrus
angulaire, il y a environ 50 000 ans, que ces facultés
langagières auraient connu une retentissante explosion.
On croit d’ailleurs que le langage articulé, tel
que nous le connaissons aujourd’hui, devait
être déjà apparu il y a 50 000 ou 60 000
ans. Car c’est à ce moment que les différentes
ethnies humaines se sont différenciées. Or toutes
ces ethnies conservent aujourd’hui la capacité d’apprendre
n’importe quelle langue parlée dans le monde.
Le polonais ou le chinois immigré à New York
fini par parler anglais avec un accent New Yorkais, et vice-versa,
preuve que nous avons tous hérité du même
potentiel linguistique.
|
Les langues évoluent
et elles changent imperceptiblement. La langue française
a évolué au fil du temps. On écrivait
« hospital » en ancien français, le " s " a été supprimé
pour devenir hôpital. Les anglicismes sont aussi une
forme d'évolution de la langue française. Des échanges
culturels influencent donc l'évolution d'une langue.
En quelques siècles seulement, une langue peut
évoluer de manière significative. Huit siècles à peine
séparent ainsi l’ancien français du français
d’aujourd’hui. Si l’on remonte encore plus
loin dans le temps, on trouve une langue comme le latin de
laquelle dérive notamment le français, l’italien,
l’espagnol, le portugais et le roumain. Les langues ayant
laissé
des traces écrites nous permettent de remonter ainsi
parfois de quelques millénaires comme pour l’indo-européen,
l’une des premières familles de langue connues. |
|
|