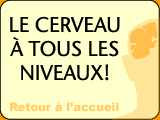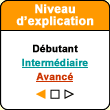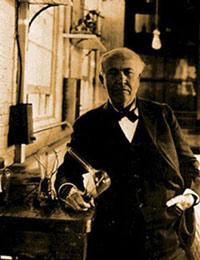Pendant des millénaires, nos
ancêtres chasseurs-cueilleurs ont évolué au rythme
des jours et des saisons. Être actif après la tombée
du jour comportait tellement plus de dangers que d’avantages que personne
ne s’y serait risqué. Puis, entre 800 000
et 400 000 ans avant notre ère, l’être humain apprit à
maîtriser le feu, ce qui amena vraisemblablement une vie
sociale plus organisée. Outre son utilité pour la cuisson
et pour contrer le froid, le feu permis d’ouvrir une brèche dans
le règne de l’obscurité de la nuit.
| Aussi tôt que 20 000 ans avant Jésus-Christ,
on trouve la trace du plus vieux système servant exclusivement à
l’éclairage : la lampe à huile. Les plus
anciennes lampes à huile étaient constituées d'une simple
pierre évidée dans laquelle une mèche trempait | |
Bien que les égyptiens et les crétois commencent à
fabriquer des chandelles à partir de la cire d’abeille
dès 3000 ans avant J-C, il faut attendre le 16e siècle pour voir
apparaître les premiers essais d'éclairage public aux chandelles.
Les attaques fréquentes dans les rues la nuit engendrant un
sentiment de peur dans la population, la Cour de Paris fait alors publier
un édit incitant les habitants à mettre à leur fenêtre
à partir de neuf heures une chandelle allumée.
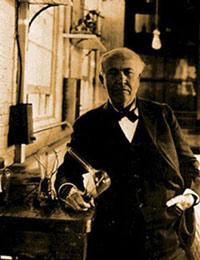 |
En 1829 la rue de la Paix est la première rue de
Paris à être pourvue d’un éclairage alimenté
au gaz. Mais c'est véritablement avec l'invention de la lampe électrique
à incandescence par Thomas Edison en 1879, et l'avènement du courant
alternatif popularisé par Nicola Tesla à la même époque,
que notre rapport à la nuit allait subir une révolution : celle
du prolongement de la journée de travail durant les heures de tout temps
consacrées au sommeil. Une simple ampoule électrique
et un type de courant efficace pour l'alimenter allaient en effet rendre possible
le roulement de l'industrie 24 heures par jour et, par là même, la
naissance des horaires de travail de nuit. |
D’autres
développements technologiques du 20e siècle comme les
vols intercontinentaux allaient aussi affecter les rythmes naturels de notre
sommeil, mais jamais à une aussi grande échelle que le travail de
nuit. Les
entreprises ne cessant de vouloir augmenter leur productivité, de plus
en plus d’employés sont appelés à travailler la nuit
ou selon des horaires de travail irréguliers. On estime que plus de 20
% des travailleurs des pays industrialisés suivent de tels horaires irréguliers
qui perturbent inévitablement leurs habitudes de sommeil. Bien
souvent, malgré des années de travail de nuit, ces travailleurs
dorment environ deux heures de moins que la durée de sommeil moyenne de
la population. Ils souffrent donc d’un manque chronique de sommeil parce
que leur organisme ne réussit jamais à s’adapter complètement
à ce mode de vie inversé. En effet, plusieurs
phénomènes physiologiques cycliques surviennent dans notre organisme
pour favoriser l’éveil durant le jour et le sommeil durant la nuit.
Le travail de nuit exige donc que notre organisme soit actif quand il voudrait
dormir. Inversement, il voudrait ensuite que vous vous endormiez alors que plusieurs
processus internes, entraînés par la luminosité du jour, tendent
à vous éveiller. Ce sommeil de moindre qualité et
de moindre durée peut non seulement amener des problèmes de santé
(fatigue chronique, ulcère, mauvaise digestion, etc.), mais il peut aussi,
par la baisse de vigilance qu’il entraîne, exposer l’individu
et parfois même toute la société à de graves accidents
(voir encadré). On distingue généralement le travail
de nuit, à horaire régulier, des quarts de travail à horaire
irrégulier, les
deux amenant des effets qui leur sont spécifiques.
|