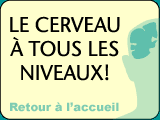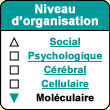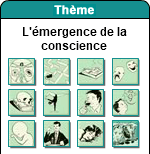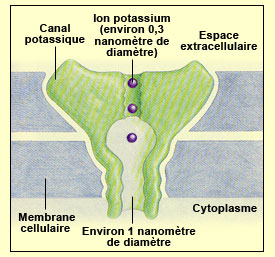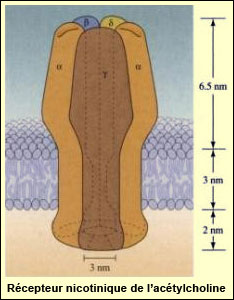|
|
|
|
 |
Le
sentiment d'être soi |
 |
|
|
|
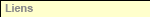
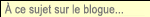
Le prix Nobel de physique de Roger Penrose comme prétexte pour causer conscience
Le principe
d'incertitude de Heisenberg, aussi appelé «principe
d'indétermination»
ou «inégalités de Heisenberg» fut énoncé au
printemps 1927 par le physicien allemand Werner Karl
Heisenberg. Ce principe affirme qu'il est impossible
de mesurer à la fois la position d'une particule en
même temps que sa vitesse de façon exacte. Plus
l'on détermine avec précision l'un, moins on
saura de chose sur l'autre. En d'autres termes, soit on peut
connaître précisément la position contre
une grande incertitude sur la valeur de sa vitesse ou soit
l'inverse, mais jamais les deux avec précision.
On peut tenter d'expliquer ce phénomène
paradoxal en posant que l'on ne peut observer quelque chose
qu'en l'éclairant avec de la lumière, autrement
dit par des photons qui sont réfléchis par cette
chose. Or à l'échelle de l'infiniment petit,
le moindre photon qui percute une particule élémentaire
comme un électron va modifier la trajectoire initiale
de ce dernier ou le faire changer d'orbitale. A cette échelle,
le photon devient un véritable projectile qui permet
peut-être de déterminer la position de l'électron,
mais qui aura en même temps modifié sa vitesse
et sa trajectoire, lesquelles ne pourront donc pas être
connues en même temps que la position (mais voir les
liens ci-bas pour une mise à jour de ces explications).
|
|
Pour la plus grande partie, la mécanique
quantique décrit des systèmes physiques en terme
de fonctions d'onde qui évoluent de manière
déterministe, en accord avec l'équation
de Schrödinger. Conçue par le physicien
Erwin Schrödinger en 1925, cette équation fondamentale
de la physique quantique décrit l'évolution
dans le temps d'une particule élémentaire.
En ce sens, elle permet la même
chose que la dynamique en mécanique classique : prédire
la position et la vitesse de n'importe quel système
de particules qui
évoluent de manière déterministe dans
le temps. La différence, c'est que ce que l'on appelle «l'onde
quantique» ne spécifie pas la position et la
vitesse en tant que telle, mais la probabilité
que des particules aient telle position et telle vitesse
quand on fait une «mesure». Et le mot mesure
est entre guillemets parce que la véritable étrangeté de
la mécanique quantique, c'est de ne pas offrir de
véritable explication de ce qui se passe lors d'une
telle mesure (voir l'encadré précédent).
On parle de «l'effondrement»
(ou de la décohérence) de la fonction d’onde
quantique pour tenter de décrire ce qui se
passe alors. Car la mesure amène on ne sait trop comment
l'onde quantique (qui en général admet plusieurs
positions et vitesses) à s'effondrer de manière
indéterminée vers des valeurs définitives.
C'est un peu comme si on joue à pile
ou face dans l’obscurité. La probabilité est
la même pour que la pièce de monnaie tombe sur
pile ou sur face, mais tant que la lumière n'est pas
allumée, on pourrait dire que la pièce qui
s'est pourtant immobilisée dans notre main est dans
une superposition d'état tant que
la lumière reste fermée. Quand on ouvre la
lumière et donc qu'on effectue une «mesure»,
on fait s'effondrer la superposition d'état en un
seul, pile ou face.
Bien qu'on puisse se le représenter
ainsi assez bien, le mécanisme de cet effondrement
n'est pas décrit par l'équation de Schrödinger
et est sujet à de nombreuses controverses.
|
|
|
| DES EFFETS QUANTIQUES À LA BASE DE
LA CONSCIENCE? |
|
Les approches cherchant à relier
la conscience à des phénomènes moléculaires
sont multiples. On y retrouve par exemple la
proposition de Flohr et de l'implication possible des récepteurs
NMDA dans nos processus conscients. Mais il existe une autre
grande famille de théories explicatives de la conscience à partir
de l'infiniment petit: celles qui s'inspirent des principes de
la physique quantique.
Certaines ne sont que spéculatives et ne
font allusion aux étranges propriétés quantiques
que de manière métaphorique. Bien qu'elles puissent
inspirer de nouvelles pistes susceptibles d'être par la suite
testées expérimentalement, elle ne représentent
pas de réels progrès scientifiques tant qu'elles demeurent
de vagues analogies.
Mais d'autres approches utilisent la
théorie quantique actuelle pour modéliser concrètement
des mécanismes physiologiques et psychologiques associés à la
conscience. Par exemple, Beck et Eccles ont
suggéré
dans les années 1990 que le caractère probabiliste
de la
relâche des vésicules de neurotransmetteurs dans
la fente synaptique serait d'origine quantique. Pour eux,
la taille extrêmement petite des sites où se fait
l'exocytose des vésicules synaptiques contenant les neurotransmetteurs
permettrait à l'incertitude quantique d’y jouer
un rôle.
Eccles décrit des structures
appelées « dendrons » formées de groupes
d'une centaine de dendrites de neurones pyramidaux du cortex.
La conscience agirait en liant réciproquement chaque dendron à l'unité d'expérience
mentale, ou « psychon », qui lui est associé.
Et c'est l'action du psychon sur les dendrons qui provoquerait
l’augmentation de la probabilité de relâche
des vésicules synaptiques dans les synapses excitatrices
de ces dendrites.
Comme on peut le constater, il s'agit
d'une hypothèse
dualiste en ce qu'elle suppose deux mondes distincts. La physique
quantique au niveau des vésicules synaptiques joue ici un
peu le
rôle de la glande pinéale de Descartes, c'est-à-dire
le lieu d'interaction entre les deux mondes. Il n'est pas inintéressant
de rappeler que, bien qu'il ait reçu le prix Nobel de médecine
en 1963 pour ses importantes découvertes sur les mécanismes
synaptiques, Eccles était un catholique pratiquant qui n'a
jamais caché sa foi en une âme humaine d'origine divine.
De toutes les théories sur la conscience
faisant appel à la physique quantique, celle qui a la plus
longue histoire fut proposée par John
von Neumann dans les années 1930, puis reprise
par Eugene Wigner dans les années 1960,
et perfectionnée encore un peu plus par Henry Stapp à partir
des années 1980.
Dans sa monographie de 1955 sur les bases
mathématiques de la physique quantique, von Neumann abordait
la difficile question de la mesure dans le cadre de la théorie
quantique, le fameux principe d'incertitude de Heisenberg (voir
l'encadré). En effet, à mesure que l'on va vers l'infiniment
petit, plus on se rend compte que ce que l’on appelle la
réalité
tend vers un état plus potentiel que réel, suggérant
que la seul fixité qu'il puisse exister à ce niveau
provient de l'acte même d'observation qui détermine
en quelque sorte un état particulier au détriment
des autres.
D’où l'idée de Von Neumann
qui veut que ce qu’on appelle « l'observateur »
d'une mesure puisse être considéré aussi bien
comme l'instrument de mesure que comme le cerveau humain qui constate
cette mesure. D'autres vont aller plus loin en affirmant que c’est
la conscience humaine qui complète véritablement la
mesure quantique, donnant à cette dernière un rôle
crucial dans l'établissement de cette mesure quantique.
|
Inspiré par
ces prédécesseurs, Stapp développe sa
propre interprétation de cette approche. Sa proposition
se base sur le principe d'incertitude appliqué aux
canaux ioniques dans les neurones, canaux dont l'ouverture
va aboutir à la relâche de neurotransmetteurs
dans la fente synaptique. Et comme ce sont ces synapses qui
déterminent nos pensées par le jeu des assemblées
de neurones, Stapp pense que des effets quantiques au
niveau de ces canaux ioniques pourraient influencer nos pensées
conscientes. |
|
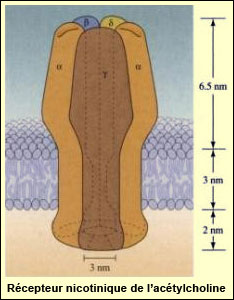
(cliquez
ici pour d'autres représentations
schématiques
de ce récepteur) |
Pour appuyer
son hypothèse, il rappelle que pour un canal ionique
de 1 nanomètre de diamètre (soit 10-9 mètre),
l'incertitude sur la vitesse est de l'ordre de 1 mètre
par seconde selon le principe de Heisenberg. Pour Stapp ces
effets sont suffisants pour donner lieu à une superposition
d'états quantiques (voir l'encadré)
que la conscience serait capable de réduire à un
seul état classique macroscopique.
Pour le dire plus simplement, Stapp pense que les ondes
quantiques s'effondrent quand des cerveaux intelligents sélectionnent
parmi les alternatives quantiques certaines d'entre elles
pour décider
de leur comportement futur. |
Cette interprétation de la mécanique
quantique est donc également une théorie de la conscience
dans la mesure où
ce sont les parties du cerveau impliquées dans l'effondrement
de l'onde quantique (voir l'encadré) qui seraient
celles qui participent à la conscience. La conscience humaine
aurait ainsi la capacité singulière de pouvoir faire
s'effondrer l’onde quantique. Autrement dit, pas seulement
la capacité de décrire la réalité physique,
mais aussi de l'influencer. Et donc d'influencer, en particulier,
l'activité du cerveau lui-même.
Stapp n'essaie donc pas tant d'expliquer
en terme quantique comment peut se constituer la conscience mais
la prend plutôt comme quelque chose qui est donné au
départ et qui peut influencer un phénomène
quantique comme l'effondrement de la fonction d’onde. Et
pour lui, cette façon de voir permettrait d’expliquer
deux choses essentielles. D'abord la fonction
adaptative de la conscience humaine qui serait d'éliminer
les réalités alternatives pour nous permettre de
mieux orienter nos actions. Et ensuite le
libre arbitre si cher aux êtres humains.
On peut dire qu'il s’agit là d'une
version plutôt radicale de ce que les neurobiologistes qui
travaillent sur l'attention appellent les
mécanismes « top down ». Une version en
tout cas trop poussée pour les
matérialistes réductionnistes qui la rejettent.
Tout au plus peut-on y discerner, disent certains commentateurs,
des points de convergence vers l'approche matérialiste de
la « théorie
du double aspect ».
D’autres théories postulant
des effets quantiques
à la base de la conscience trouvent la théorie quantique
actuelle incomplète et misent sur des développements
futurs de celle-ci pour rendre compte de leurs intuitions. C’est
le cas, par exemple, du modèle
de Penrose et Hameroff.
La théorie de
la décohérence essaie de résoudre
la difficile question de savoir pourquoi le monde macroscopique
n'est pas quantique.
La fameuse expérience de pensée
du «chat de Schrödinger» permet
de saisir l’ampleur de la difficulté. Un chat
est dans une boîte opaque fermée avec une capsule
de gaz mortel. La capsule n'émettra le poison que
si un électron tiré d'un canon situé un
peu plus loin frappe la moitié supérieure d'un
détecteur (et non sa moitié
inférieure).
Or l'onde quantique de ce système
donne autant de chance à l'électron de frapper
la partie du haut que la partie du bas du détecteur.
Le destin du chat n'est donc pas décidé tant
que la fonction d'onde ne s'est pas effondrée (voir
l'encadré ci-contre) et que l'on ne sait pas si l'électron
a atteint la partie du haut ou la partie du bas du détecteur.
Mais quand cela se produit-il ? Quand
les choses deviennent-elles déterminées, définitives
? Quand la capsule se brise ? Quand le chat respire le poison
? Ou seulement quand il meurt ou survit ? Et c'est là que
cela devient pour le moins étrange car si l'on se
fie seulement
à l'équation de Schrödinger, cela ne nous
aide en rien puisqu'elle considère le chat comme une
superposition des deux états, mort et vivant ! Exactement
comme elle voit l'électron comme une superposition
de deux trajectoires, vers le haut ou vers le bas du détecteur.
La physique seule ne semble donc pas
pouvoir nous dire quand les choses deviennent définitives.
D'où l’idée, dont Stapp se fait le défenseur,
que la fonction d'onde pourrait s'effondrer seulement au
moment où elle interagit avec la conscience. Rien
ne pourrait donc avoir besoin d'être défini
jusqu’à ce qu'il soit consciemment perçu
par un observateur. Si cela était vrai, alors le chat
de Schrödinger ne serait ni mort ni vivant jusqu’à ce
qu'un observateur ouvre la boîte et regarde à l'intérieur.
|
|
|