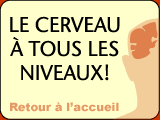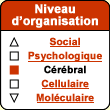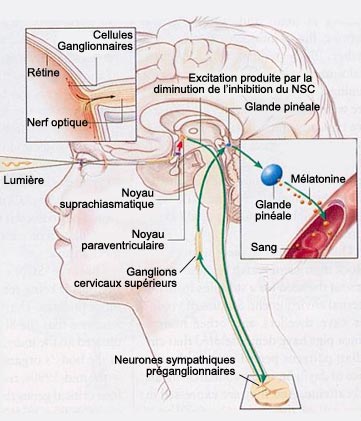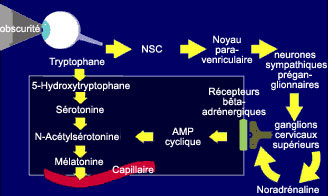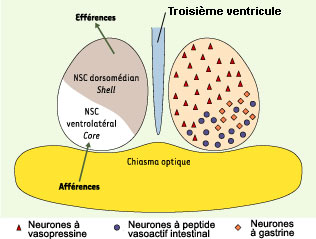|
|
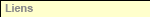
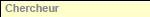
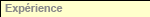
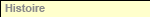
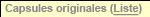
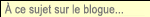
Lumière,
mélatonine et système immunitaire
Des récepteurs à la
mélatonine sont présents sur les
neurones des noyaux suprachiasmatiques de la plupart des
espèces. Ceci suggère une régulation
de type rétroaction négative pour la sécrétion
de la mélatonine. Des expériences ont d’ailleurs
démontré que la mélatonine exogène
est capable d'agir sur le fonctionnement de l'horloge biologique
en entraînant l'activité locomotrice circadienne
de différents rongeurs.
|
|
|
| LE NOYAU SUPRACHIASMATIQUE
ET LA GLANDE PINÉALE |
|
A l'origine des rythmes
circadiens se trouvent les noyaux suprachiasmatiques (ou NSC), oscillateur
central de notre horloge biologique. Ces deux noyaux de l'hypothalamus
antérieur de quelques dizaines
de milliers de petits neurones chacun ont un rythme d'activité biochimique
et électrique spontané. Celle-ci est cependant entraînée
et synchronisée par la lumière du jour par l'entremise
de la voie rétino-hypothalamique.
À partir des noyaux suprachiasmatiques, les
informations sont relayées à plusieurs structures dont
la glande pinéale par une voie polyneuronale complexe.
On s’attendrait en effet à ce que les voies nerveuses
qui relient ces deux structures du diencéphale le
fassent directement. Or il n’en est rien : elles font
un long détour par la moelle épinière, avant
de revenir à la glande pinéale située pourtant
tout près de l’hypothalamus.
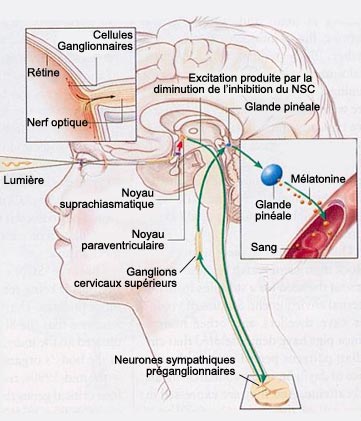 |
Durant la journée, l’activité
du NSC diminue celle d’une autre région de
l’hypothalamus, le noyau paraventriculaire (la
flèche rouge indique cette inhibition). Les axones
du noyau paraventriculaire descendent ensuite jusqu’aux neurones
sympathiques préganglionnaires de la corne
latérale de la
moelle épinière. À leur tour,
ces cellules modulent l’excitabilité de neurones
des ganglions cervicaux supérieurs dont
les axones projettent finalement sur la glande
pinéale (aussi appelée épiphyse). |
Tout ce trajet excitateur est indiqué en vert sur le schéma
ci-haut. Comme il n’y a qu’une connexion inhibitrice
(celle du NSC au noyau paraventriculaire) dans ce circuit, on comprend
comment l’excitation lumineuse de la lumière du jour
dans le NSC diminue en bout de ligne la production de mélatonine
par la glande pinéale. Inversement, quand le soleil se couche,
l’influence de la connexion inhibitrice diminue et permet
aux connexions excitatrices d’augmenter la sécrétion
de mélatonine dans la pinéale.
| C’est
la noradrénaline qui est le neurotransmetteur principal
régulant l'activité de la glande pinéale.
En se fixant sur ses récepteurs, la noradrénaline
active une cascade de seconds messagers faisant intervenir
l’adényl cyclase et son produit l’AMP cyclique.
Cet AMP cyclique contribue à la synthèse de la
mélatonine à partir de son précurseur
le tryptophane. |
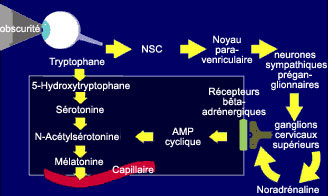 |
Cette mélatonine est
déversée
dans la circulation sanguine et peut ainsi atteindre tous les organes
du corps. C’est ainsi qu’elle participe
à la modulation des circuits du tronc cérébral
qui contrôlent en dernier ressort le
cycle veille-sommeil.
Les noyaux suprachiasmatiques
ne sont plus considérés comme une entité
uniforme, mais à
l'instar d'autres noyaux plutôt comme un ensemble
d’unités fonctionnelles distinctes et interconnectées.
En s’appuyant sur les neuropeptides produits par les
différents neurones des NSC ainsi que sur l’organisation
fonctionnelle des afférences et des efférences
de cette structure, on distingue maintenant le NSC ventral et
le NSC dorsal.
Il semble que les neurones du NSC
ventral seraient moins des horloges mais plutôt l'endroit
du NSC qui reçoit les afférences tandis que
ceux du NSC dorsal constitueraient la véritable
horloge endogène robuste du NSC. De plus, certains
travaux ont démontré chez le rat que, dans
une situation de décalage horaire, l’entraînement
lumineux qui permet de resynchroniser l’horloge se
ferait beaucoup plus rapidement dans le NSC ventral que
dans le NSC dorsal.
Or on a découvert que le neurotransmetteur
GABA excite les cellules du NSC dorsal mais inhibe celles
du NSC ventral. Des effets opposés pourraient avoir
une influence sur le temps de réaction différent
des deux sous-régions du NSC lors d’un changement
d’horaire. Cette découverte ouvre donc de nouvelles
perspectives sur les mécanismes
à l’origine du malaise ressenti lors d’un décalage
horaire.
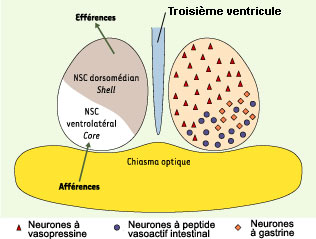
Source: Hugues
Dardente et Nicolas Cermakian, Médecines/Science,
Volume 21, numéro 1 (Janvier 2005)
|
|
|