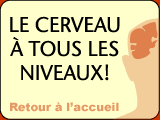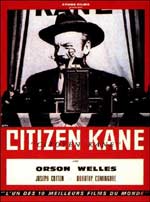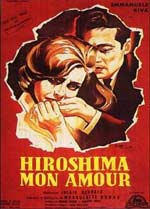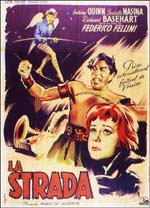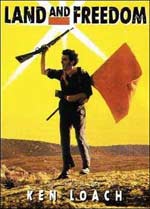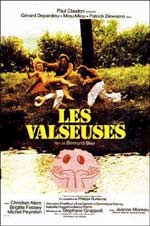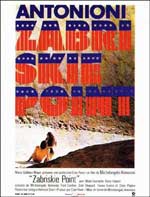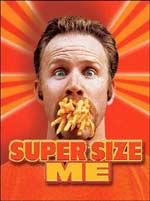| LE CINÉMA: LA GRANDE
ILLUSION | | Depuis
ses origines, l’être humain a toujours eu le besoin de raconter
des histoires, que ce soit la sienne ou celle d’un autre groupe humain.
Aller voir un film dans une salle obscure est un rituel bien implanté dans
nos
sociétés qui s’inscrit dans la continuité de cette
tradition. Le cinéma tire sa puissance évocatrice de l’illusion
du réel, et donc de l’impression
de mouvement qu’il est capable de produire.
Pour bien
discerner les mécanismes qui rendent possible cette illusion à partir
du défilement
de la pellicule dans le projecteur, il est pratique d’y voir deux problèmes
distincts à résoudre. D’une part les écrans noirs entre
les images que l’on ne perçoit pas, pas plus d’ailleurs que
le scintillement de l’écran provoqué par l’alternance
des images et des noirs. Et d’autre part l’illusion centrale du cinéma,
c'est-à-dire le fait que nous interprétons une succession d'images
fixes légèrement décalées comme étant une image
unique qui bouge. Dans les deux cas, le rôle de la
persistance rétinienne longtemps invoquée comme principe explicatif
à la base même du cinéma, serait négligeable.
À cause des contraintes
liées aux écrans d'ordinateur, cette animation ne peut malheureusement
présenter qu'une approximation de l'effet réel. | Le
premier problème a été résolu en doublant (pour les
films actuels tournés en 24 images par seconde) ou en triplant (pour les
films anciens tournés à 16 images par seconde) le nombre d’images
qui s’affichent successivement sur l’écran. On obtient ainsi
près de 50 images par seconde, seuil à partir duquel le scintillement
devient trop rapide pour qu’on le perçoive (voir encadré).
Où sont alors passé les « noirs » qui comptent pourtant
pour près de la moitié du temps de projection ? Il semblerait que
la persistance rétinienne n’y soit pour rien et que notre cerveau
n’en tient tout simplement pas compte parce qu’ils constituent pour
lui une absence d’information. | Pour ce qui
est du second problème, il est maintenant admis que ce qui nous fait percevoir
du mouvement là où il n’y a que succession rapide d’images
fixes est un effet psychologique qui n’a lui non plus rien à voir
avec la persistance rétinienne: l’effet bêta.
Réduit à sa plus simple expression, l’effet bêta peut
être produit par deux
points lumineux légèrement décalés qui s’allument
et s’éteignent successivement. Bien qu’il n’y ait
aucun mouvement effectif, nos processus perceptifs vont cependant lier subjectivement
les deux points en un seul qui se déplace. Sur le même principe,
mais en plus complexe, on retrouve les tableaux d’affichages sportifs ou
publicitaires faits de centaines de petites lumières qui, en s’allumant
successivement, peuvent provoquer des effets de mouvement tout à fait réalistes. 
L’effet
bêta peut aussi créer l’illusion d’un mouvement qui se
rapproche ou s’éloigne des spectateurs. Quand par exemple on présente
une suite d’images de plus en plus petites du même objet, les gens
vont généralement ressentir ce changement comme un éloignement
de l’objet. Et l’inverse, c’est-à-dire un rapprochement,
si les images sont de plus en plus grosses. De la même manière, si
la première image représente un objet aux couleurs vives et que
la seconde représente le même objet mais avec des couleurs plus ternes
et plus proches de celles la toile de fond, les gens disent habituellement que
l’objet s’est éloigné d’eux. On voit donc que
l’effet bêta est non seulement à la base de l’illusion
du mouvement de tout type de cinéma, mais qu’il est aussi à
la base de nombreux subterfuges graphiques dans le cinéma d’animation.
La fréquence à laquelle le scintillement
causé par une succession d’images devient imperceptible pour notre
système visuel est appelé le seuil de fusion d'une lumière
scintillante. Ce seuil n’est pas absolu mais dépend du niveau
d’illumination de l’image, étant plus élevé pour
des images plus claires. Il dépend également de la région
de la rétine où se projette l’image : les bâtonnets
ont une réponse plus rapide que les cônes, de sorte que le scintillement
peut parfois être vu dans notre champ de vision périphérique
alors que notre vision centrale, assurée par la
fovéa composée de cônes, en est dépourvue.
|
L’illusion du mouvement à la
télévision provient également d’une succession
rapide d’images fixes. Celles-ci ne sont cependant pas produites par des
images sur une pellicule mais bien par un faisceau d’électrons qui
balaie l’intérieur de l’écran cathodique à grande
vitesse. Comme celui-ci est enduit de phosphore, le faisceau d’électrons
dont l’intensité est variable laisse quelques instants derrière
lui un trait lumineux plus ou moins intense.
Sur une télévision
conventionnelle, le faisceau d’électrons reconstitue chaque image
en traçant de haut en bas de l’écran 525 (pour le NTSC) ou
625 (pour le PAL/SECAM) lignes horizontales selon le standard de votre pays. Les
caméras vidéos enregistrent quant à elles 25 (PAL/SECAM)
ou 30 (NTSC) images par secondes. Par conséquent une télévision
affiche une nouvelle image 25 ou 30 fois par seconde.
Comme il n’est
pas possible d’utiliser un obturateur pour doubler le nombre d’images
à la seconde afin d’éliminer le scintillement de l’image,
une autre stratégie est adoptée: chaque image est scannée
en deux temps, une première passe où le faisceau d’électrons
trace les lignes impaires, et une seconde où il trace les lignes paires.
Chaque image est donc formée de deux champs ce qui fait que 50 ou 60 champs
sont présentés par seconde, éliminant ainsi le problème
du scintillement de l’image. |
|