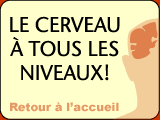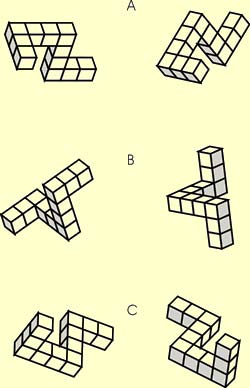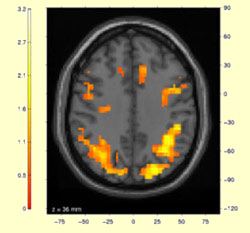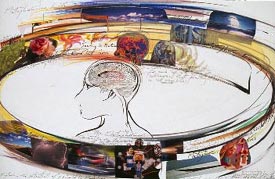|
|
| |
 |
| Produire un mouvement volontaire |
 |
| | |
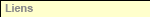
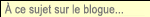
Reconsidérer
les fondements des sciences cognitives
«
La cognition incarnée », séance 10 : Comment
l’environnement entre dans notre cerveau (cognition ancrée
et représentation modale)
Cerveau-corps-environnement,
l’indissociable trio qui nous permet de penser
Le rôle de l’imagerie
mentale dans l’amélioration de la performance motrice et
l’apprentissage
du mouvement n’est plus mis en doute. Les travaux actuels s’attachent
maintenant à identifier les déterminants de son efficacité.
On a ainsi montré que les progrès sont plus marqués chez
les gens qui ont une meilleure capacité à générer
des images mentales. Ils le sont également lorsque la pratique réel
du mouvement a précédé le travail mental. |
Le concept d’imagerie motrice
s’étend aussi aux modalités sensorielles : vivre une expérience
sensorielle quelconque et se la représenter par la suite mentalement produit
une activité cérébrale similaire en terme de localisation
et d’intensité. L’activité du cerveau influençant
constamment le corps et vice versa, toute expérience vécu a un effet
donné sur le corps, et le fait de la visualiser à nouveau engendrerait
un activité semblable qui aurait des effets comparables sur le système
endocrinien, immunitaire, etc.
De façon très générale,
on peut donc considérer la visualisation comme une forme d’auto-suggestion
ou d’auto-hypnose qui, en générant des émotions, peut
avoir un effet physiologique bénéfique sur le corps. Les mécanismes
précis de cette interaction sont encore mal connus, mais de nombreuses
études ont pu en démontrer les effets physiologiques réels. |
| |
| L'IMAGERIE MENTALE D'UNE ACTION |
| Les processus les plus
élaborés de l’activité psychique humaine sont rendus
possibles grâce à des entités mentales pouvant se substituer
à l’objet réel. Jusqu’à la fin des années
1970, on pensait que toute information, quelle que soit sa modalité sensorielle,
produisait dans le cerveau une représentation mentale indépendante
de cette modalité. Comme on considérait que cette représentation
n’était qu’un épiphénomène, on n’accordait
aucun rôle fonctionnel aux images mentales dans le développement
de la pensée ou de l’action. Mais les résultats expérimentaux
qui suivirent montrèrent que l’imagerie mentale était au cœur
de la vie psychique de l’individu. Elle interagit en effet avec tous les
autres grands systèmes cognitifs comme la
perception visuelle, le langage ou la
mémoire.
Mais surtout, les travaux portant sur l’imagerie
mentale ont montré l’identité des processus de production
réelle et de représentation mentale du mouvement. Diverses voies
expérimentales ont été utilisées pour montrer, par
exemple, que la représentation mentale de l’action semble reposer
sur les mêmes mécanismes que la préparation motrice.
Avec la chronométrie
mentale par exemple, on a pu montrer que les images mentales visuelles préservent
les caractéristiques spatiales et structurales de l’objet ou de la
scène qu’elles représentent. Il a par exemple été
établi que le temps de déplacement visuel entre deux points d’une
image mentale était proportionnel à la distance séparant
ces deux points sur l’objet réel. Ou encore, si on demande à
des sujets soit de prononcer, soit d’imaginer prononcer le plus vite possible
des nombres entiers ou encore l’alphabet, on obtient des temps comparables
pour la production verbale réelle et pour sa représentation mentale.
Les expériences de Parsons sur la rotation mentale d’objet aboutit
aux mêmes conclusions : le temps de rotation mentale d’un objet est
proportionnel à l’angle de la rotation effectué. Par exemple,
les sujets doivent décider si une main présentée en photographie
correspond à la main droite ou à la main gauche. Et encore une fois,
ils mettent autant de temps à prendre la décision qu’à
faire une rotation réelle de leur main pour atteindre la position présentée.
La constante des résultats de chronométrie mentale est donc la similarité
frappante des durées d’actions réelles et représentées
mentalement. On a aussi trouvé des indices physiologiques dont l’activation
résultait uniquement de l’imagerie mentale d’une action. Par
exemple, certains ont mesuré l’effet de l’entraînement
physique ou mental sur la force musculaire d’un doigt. Si l’on note
une augmentation de la force musculaire de 30 % après l’entraînement
physique, l’entraînement mental seul produit tout de même une
augmentation de cette force de 22 % ! Or comme aucune contraction musculaire n’a
été effectuée durant l’entraînement par imagerie
mentale, le changement observé ne provient pas du niveau périphérique
mais bien de l’activation de circuits moteurs centraux.
Autre
exemple : les sujets devaient s’imaginer marcher ou courir à différentes
vitesses sur un tapis roulant. Leur rythme cardiaque et leur ventilation totale
augmentent alors proportionnellement à la vitesse imaginée au cours
de cet exercice mental (tandis que leur consommation d’oxygène reste
stable). | 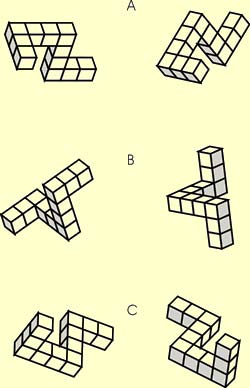
Pour déterminer si les deux objets sont les
mêmes, le sujet doit en faire une rotation
mentale afin de les comparer.
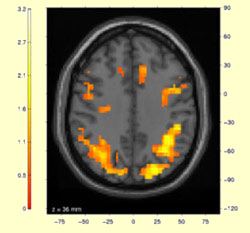
Région cérébrales activée
par la rotation mentale d’objets
Source : University of Melbourne
Neuroimaging and Informatics
|
Selon la théorie que le neurobiologiste
David Ingvar a joliment nommé la "mémoire du futur", le
cortex
pariétal serait capable de produire des modèles internes des
mouvements à effectuer, en amont des cortex prémoteur et moteur.
Cette région du cerveau simulerait des actions en permanence et seulement
certaines d’entre elles seraient éventuellement extériorisées.
Cette théorie pourrait donner un socle conceptuel à l'entraînement
mental des sportifs et des musiciens ainsi qu’à la rééducation
par l'imagerie motrice. 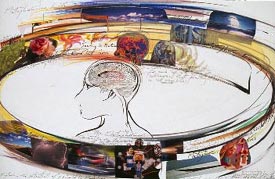
Source : Todd Siler

| |
|